Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Le Mali, a progressivement implémenté ces innovations dans les domaines :


La question du concept et de son effigie Le concept est une représentation mentale générale et abstraite d’une chose, d’un objet. Cette représentation renvoie toujours à une image qui est le double du concept ou encore ce que nous appelons « l’effigie du concept ».
La représentation plastique d’un concept est à priori le résultat d’un long processus de création. Et, par conséquent, les difficultés liées à l’interprétation des cultures étrangères sont tributaires de l’appréciation des concepts engendrés par ces cultures, moins de la seule volonté du chercheur, même si celui-ci bénéficie des instruments de recherches qui font écho à la science. … La question justement pour nous consiste à vérifier une définition du concept qui contient en son sein deux éléments essentiels complémentaires : le signe iconique et le signe abstrait, c’est-à-dire la représentation et l’image, la fonction matérielle et la fonction interne, visuelle et déductive, etc. L’effigie, qui est un reflet du modèle, peut être aussi l’incarnation profane d’une sculpture d’ancêtre tel qu’on le voit aujourd’hui avec des « antiquaires » ou encore des « faussaires ». Alors, lorsque la tâche délicate du critique, investi de la redoutable mission de « juger » est d’apporter des appréciations sur une œuvre dont il ignore l’essence, il va de soi qu’il ira « pédaler à côté du vélo », comme dirait l’autre. Le résultat peut être dévastateur ou tout simplement ridicule car ne répondant aucunement aux aspirations et aux préoccupations des populations qui l’ont engendrée. C’est donc cette effigie, ou encore « le double » du concept qui, pour nous, semble être l’élément de désintégration de l’art contemporain africain. Car elle est fondamentalement mal perçue. Par conséquent, le critique d’art, contre toute attente, va « fabriquer, pour lui-même, un art africain » en l’observant, bien entendu, sous l’aune classique de l’esthétique occidentale, une sorte d’appropriation « d’imagessur l’Afrique, et non d’images d’Afrique ».
Quelle image et quelle terminologie pour l’Afrique ? La question rejoint plutôt celle relative à une réécriture de l’Histoire africaine. Elle réside surtout dans le dynamisme que les intellectuels africains (historiens, critiques d’art, etc.) déploieront pour proposer une nouvelle vision aux critères de choix, par exemple, des œuvres d’art réalisées sur le continent. Pourquoi les formes de conscience sociale en Afrique doivent-elles forcement refléter les catégories esthétiques occidentales ?


Date : 25 septembre 2021
Lieu : Salle de Conférence de l’ex FLASH, Campus universitaire de Badalabougou
Résumé: Le territoire est un construit social inscrit dans l’espace. Il nait de la synergie d’actions qu’entretient un groupe d’humains avec un milieu de vie. Au sud du Mali, sous l’impulsion de la culture du coton et de ses effets, les sociétés humaines et les milieux qui les sous-tendent ont connu d’importantes transformations structurelles, de l’organisation sociale au sein de la famille à la configuration des paysages ruraux et urbains. Ces changements ayant touché les dimensions sociale, économique et écologique de la région ont favorisé l’émergence de nouvelles territorialités. Cette trajectoire de réussite particulière en Afrique au sud du Sahara a été sujette à plusieurs qualifications : « Success story », « Développement inégalé », « Développement intégré », etc. Sur la base d’un ensemble de travaux réalisés dans la zone, cette communication retrace la trajectoire de développement territorial des zones cotonnières en termes de production agricole, d’accès aux services sociaux de base et de développement des villes. Malgré la réussite relative qu’ils ont connue, les territoires au sud du Mali font face à de nouveaux défis de développement durable comme la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’adaptation de l’agriculture aux contraintes climatiques, la création de plus de valeur ajoutée au niveau local, les implications de la forte croissance démographique et l’inclusion sociale.

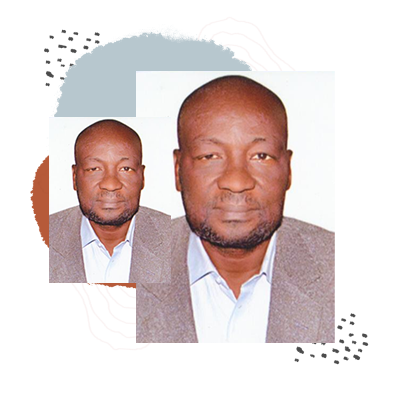
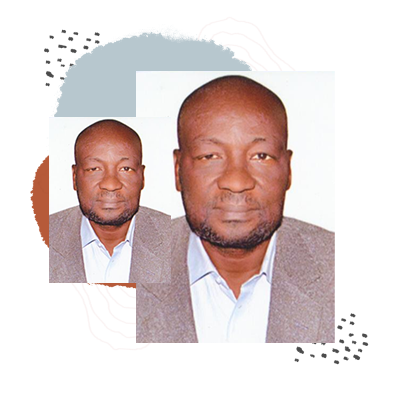

Résumé : L’ORL est une spécialité médico-chirurgicale qui s’occupe du diagnostic et du traitement des affections de l’oreille, du nez, de la gorge, de la face et de la région du cou. On parle d’ORL et chirurgie de la face et du cou (chirurgie cervico-faciale).
Les pathologies ORL sont fréquentes et graves car elles peuvent engager le pronostic fonctionnel et ou vital. Elles représentent un problème de santé publique à cause de leur grande fréquence, leur impact négatif sur la qualité de vie et le coût élevé de leur prise en charge.
L’altération de la qualité de vie est importante en raison des troubles de la communication, de la déglutition, de la stigmatisation et des séquelles esthétiques de certaines affections chirurgicales notamment les cancers du larynx.
La prise en charge est difficile surtout dans les pays en développement qui, pour la plupart, ne disposent pas de système de sécurité sociale et d’un plateau technique adéquat.
Afin d’améliorer la qualité de vie des patients souffrant de ces pathologies, il faut mettre en place un système de soins accessible, assurer une meilleure relation médecin-malade, promouvoir des mutuelles d’entraide et la politique d’assurance maladie, mettre un accent sur la formation de spécialistes.

